Comme bon nombre d’enseignants de « ma génération », j’ai beaucoup fréquenté les grand-messes des NTIC, puis des TICE et enfin du numérique. Depuis leurs stands, les commerciaux m’expliquaient que leur solution (logiciel, application, objet connecté, robot, etc.) allait modifier les pratiques enseignantes ou, plus modestement, la façon d’enseigner. À l’instar de beaucoup de profs geeks, il m’a fallu plusieurs années pour comprendre où le bât blessait: on prête depuis (vous retrouverez des traces de ce discours déjà ancien sur cette frise) à la technique des propriétés qui ne lui appartiennent pas. Les techniques ne changent pas les pratiques enseignantes, ce sont les enseignants qui changent leurs pratiques. Ils peuvent, pour ce faire, recourir à de nouvelles techniques ou des techniques nouvelles… ou pas.
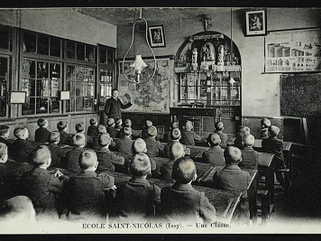


C’est en lisant Simondon et Morozov que j’ai commencé à percevoir ce qui me gênait dans ce discours. Chez Simondon, on peut retrouver l’origine de l’erreur culturelle qui conduit à prêter des intentions aux machines. Chez Morozov, on retrouve l’idée que la technique est intrinsèquement porteuse d’une solution aux problèmes qui apparaissent. Toutefois, si le discours commercial recouvre ces aspects, ce n’est que partiellement. Ces lectures m’ont conduit à imaginer que l’erreur est animiste. À la fois, il s’agit d’une erreur culturelle -on prête bien une intention aux machines-, mais cette « intention machinique » s’orienterait « naturellement » vers la bonne solution aux questions soulevées.
Il s’en suit un discours que l’on peut caricaturer par « Ma solution« , suivi d’un verbe d’action « fait ceci » ou « permet cela« . C’est ce genre de discours que je qualifie d’animiste au sens où il laisse supposer qu’elles seraient animées d’une volonté propre.
Celles et ceux qui se rappellent encore du web des années 90 ont peut-être quelques souvenirs de cette petite animation qui générait des phrases de politiciens: le Pipotron. L’idée de base était d’utiliser quelques bribes de phrases pour générer aléatoirement des propositions censées, mais vides de sens.
Ce genre de petit générateur est un peu passé de mode aujourd’hui, mais il avait l’avantage de permettre de déconstruire une forme de rhétorique qui, à défaut d’être porteuse de sens, permet de meubler une interview sans risque réel pour le locuteur.
Comme bon nombre des explorateurs du web de cette époque, j’avais un peu oublié ce petit jeu qui au-delà de la curiosité, et des deux ou trois premières minutes, lassait assez vite. Mais j’ai décidé de tester mon hypothèse en reprenant l’idée d’un générateur aléatoire qui serait basé sur la structure animiste des propositions que je croyais avoir identifiée.
Il s’agit de faire passer des propositions aléatoires pour des discours d’experts. Le diaporama suivant propose 5 réflexions « d’experts ». Il suffit alors de demander au public s’il est d’accord ou pas avec les propositions et d’argumenter son choix.
Le public est généralement d’accord avec les propositions. Comme il s’agit d’un générateur aléatoire, la supercherie devient parfois visible quand les propositions sont trop proches l’une de l’autre. Ce n’est pas gênant si on est un peu joueur.
Le second volet consiste à jouer un peu avec le moteur du générateur. J’ai appelé ce moteur G.é.r.a.r.d. pour Générateur Éducatif de Rédaction Automatique de Récits Discutables. Ce qui m’a paru intéressant, c’est de pouvoir conserver la structure animiste des propositions et d’en faire varier les paramètres.
Il est ainsi possible d’être pour ou contre, avec plus ou moins de nuance, et point plus intéressant, me semble-t-il, de recourir à des techniques non numériques. Ce moteur met le public, quand il n’a pas d’appuis théoriques pour le faire, en difficulté pour pouvoir argumenter, y compris quand on passe du pour au contre.
À la fin de cet article, j’espère vous avoir (un peu) convaincu du biais qui existe lorsqu’on prête aux techniques éducatives des vertus qui sont ou devraient être celles de l’enseignant. Les techniques, notamment numériques, peuvent être des éléments environnementaux puissants pour aider l’enseignant à faire évoluer ses pratiques ou sa façon de faire, mais elles ne sont pas intrinsèquement porteuses de changement de pratiques. Il y a quelques années, j’utilisas le terme d’amplificateur pour parler de ce qui était encore des TICE. Il semble salutaire de dire « l’enseignant·e va mettre en place cela » plutôt que « telle technique va permettre cela ». Cela pourrait nous permettre de ne pas tomber dans l’illusion de la recherche solutionniste d’un changement qui appartient aux enseignants.
Ce travail a été facilité par la réalisation préalable de Christian FÉRON (à visiter ici). Un grand merci à lui.
